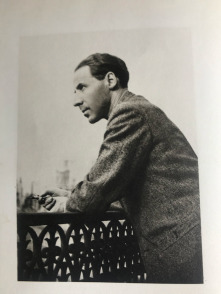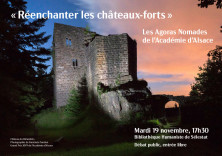Pertinence et intelligence artificielle
par Daniel Guinier
Expert de justice honoraire, ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye, chargé d'enseignement universitaire et conférencier
La recherche de « pertinence » – trouver l’adéquation entre une idée et une action, un projet – est bousculée, stimulée, par l’intelligence artificielle qui sait analyser massivement les mégadonnées et en extraire des préconisations. Mais quel rôle pour l’humain face aux vertigineux défis de la société numérique ?
Réseaux sociaux alternatifs : Légitimité,
menaces et questions émergentes
par Daniel Guinier
Expert de justice honoraire, ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye, chargé d'enseignement universitaire et conférencier
Au niveau mondial, des milliards d'utilisateurs ont recours aux réseaux sociaux. Cependant, au cours de ces dernières années, un nombre croissant d'entre-eux se sont tournés vers des réseaux sociaux alternatifs, dénommés "Alt-Techs". Si les motivations à ce changement sont claires concernant la liberté d'expression justifiée par l'absence de censure et de modération de contenu, d'autres le sont beaucoup moins quand ils sont le refuge de groupes extrémistes radicaux et criminels, et favorisent leurs activités.>>>> Le texte ici
Notre vie linguistique
par Paul Adolf
Linguiste, créateur de l' « Université Populaire sans frontières » d'Obernai, auteur de méthodes d’apprentissage de l’anglais par le dialecte alsacien.
Plus d'un Alsacien vit avec une ou plusieurs langues par jour, et pas seulement le français et l'alsacien.. Cette ambivalence linguistique, ne disons pas schizophrénie linguistique, a été >>>(la suite ici)
L'engagement en science
Hervé This
Physico-chimiste INRAE, Professeur AgroParisTech, Directeur de l'INRAE-AgroParisTech International Centre of Molecular and Physical Gastronomy, Directeur de la Fondation Sciences&Culture Alimentaire (Académie des sciences)
Une réflexion sur l'engagement, qui a été publiée par la revue Akademos, à l'occasion de la Conférence Nationale des Académies, en 2023.
Le texte ici : >>>>>
Face aux cyber-menaces
Limiter le risque de nos automatismes de pensée
Daniel Guinier
Expert de justice honoraire, ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye, chargé d'enseignement universitaire et conférencier
S’appuyant notamment sur la psychologie cognitive, Daniel Guinier éclaire notre dualité, entre automatisme et rationalité, lorsqu’il est question de cyber-attaques. Pourquoi nos prises de décision sont-elles biaisées, surtout dans les situations d’urgence, de menaces ? Quels apprentissages envisager pour se protéger ?
Certains parlent d'aliments qui seraient "ultra-transformés", mais cela a-t-il un sens ? Pas sûr !
Hervé This
Avec l’urbanisation, l’industrie alimentaire s’est développée, rationalisant les productions (Chaouad et Verzeroli, 2018), améliorant les techniques de conservation classiques, en même temps qu’elle
introduisait de nouveaux procédés (appertisation, froid, atmosphères modifiées, conservateurs, ionisation, etc.), afin d’être en mesure de proposer à tout moment de la journée des aliments auxquels
le public réclame d’être sains et bon marché (This et Pascal, 2011), voire prêts à la consommation, avec seulement, parfois, une dernière étape de réchauffage.
Cette évolution a des conséquences [...]
Ingérence de l'intelligence artificielle
dans la recherche scientifique
Daniel Guinier
Soutenues par la convergence technologique, les avancées spectaculaires en intelligence artificielle (IA) semblent offrir des opportunités pour la recherche et la connaissance scientifiques, notamment avec les grands modèles de langage génératifs, qui constituent une des approches les plus prometteuses. Les futurs systèmes d'IA pourraient accompagner les chercheurs dans leurs activités, vu la croissance non contenue de la littérature scientifique, avec actuellement plusieurs millions d'items publiés annuellement.
Deepfakes : la lutte est engagée
Daniel Guinier
La technologie invite un jour au progrès et le lendemain dévoile son côté obscur et ses effets pervers. L'ère numérique n'échappe pas à cette règle. Elle est amplifiée par la présence d'un écosystème technologique convergeant en mesure de générer rapidement des déviances sans frein pour les limiter. Ainsi, aux bienfaits du numérique, de l'Internet et de l'intelligence artificielle (IA), vient se greffer la part négative, avec notamment la désinformation de masse et l'ingérence au travers des réseaux sociaux et les deepfakes.
Daniel Guinier : Déploiements de constellations de satellites et attente de règles internationales
Le nombre de satellites mis en orbite terrestre depuis le début de l'ère spatiale, en 1957, dépasse les 15000, dont moins de 10000 sont toujours dans l’espace et 7400 toujours en activité, Ils sont accompagnés de 30000 débris et de 900000 éclats d'un à dix centimètres et 128 millions de moins d’un centimètre, ce qui constitue un grave danger pour le trafic spatial.
Les satellites actifs doivent maintenant esquiver les fragments d’objets lancés il y a des décennies, tant les orbites basses sont encombrées, et des cadres juridiques s'imposent.
Bernard Reumaux : La grâce des cathédrales, ou l'héritage vivant d'un peuple
Ce texte fut publié à l'occasion du colloque 2017 de la Conférence nationale des académies, qui s'est tenu à Paris sur le thème de l'Héritage.
Jean Richert et Charles Hirlimann : Intelligence artiricielle, neurosciences, biotechnologies : vers quel humanisme ?
Le colloque de la Conférence nationale des Académies (CNA 2022) s’est tenu du 5 au 8 octobre 2022 dans la ville de Caen, qui abrite à la fois le souvenir de Guillaume le Conquérant et la plus vieille Académie après l’Académie française.
L’Académie de Caen avait choisi d’éclairer la voie de l’intelligence artificielle, dans laquelle s’engagent nos sociétés, en posant la question : « Intelligence artificielle, neurosciences, biotechnologies : vers quel humanisme ? ».
Cent cinquante personnes environ se sont réunies dans les locaux prestigieux de l’Abbaye aux Hommes, dans l'ancien réfectoire des moines et la salle du Palais des ducs, pour réfléchir sur le sujet à partir d’une douzaine d’exposés. De nombreux questionnements ont donné lieu à des discussions quelques fois vives, mais courtoises, qui se sont souvent prolongées pendant les périodes de socialisation. La marque de ces journées de réflexion a, sans conteste, été la multidisciplinarité des approches : philosophique, scientifique, technologique, sociologique, historique. Une occasion unique pour chacun d’élargir son point de vue.
La délégation alsacienne, forte de sept membres, a soutenu avec ferveur notre confrère Jean Richert lors de son ouverture du colloque par un rappel historique de l’origine de l’intelligence artificielle.
Le texte de l'intervention ici
Daniel Guinier
La Terre souffre et nous alerte
Ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye, chargé d'enseignement universitaire et conférencier, notre confrère Daniel Guinier examine les signaux destinés à l’humanité que nous envoie la Terre à propos du dérèglement climatique. Il s'interroge sur les causes, sur le rôle des techniques, et sur certaines controverses. Il invite à considérer les changements urgents qui s’imposent au monde entier pour éviter la désintégration du "système Terre", en entrant dans une nouvelle ère dénommée noocène, mettant ainsi fin à l'anthropocène responsable de la situation.
Daniel Guinier
"Datamnésie" : Pour un droit à l'oubli des données personnelles face à la démesure
Ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye, chargé d'enseignement universitaire et conférencier, Daniel Guinier plaide pour une "datamnésie" sélective, un droit à l'oubli et la confidentialité des données personnelles, en particulier en matière d'intelligence artificielle. Et, surtout, il ouvre des pistes pour le désapprentissage.
Gabriel Braeuner
L’incorporation de force : un crime contre l’humanité ?
Il y a 80 ans, le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner instaurait l’incorporation de force dans l’armée allemande des jeunes Alsaciens et Mosellans. 40.000 d’entre eux ne sont jamais revenus. Quelles leçons en tirer pour l’histoire ?
Hervé This
Science, technologie, technique... et instruction
Le titre du présent texte correspond à une partie d’un livre, le Cours de gastronomie moléculaire N°1 (Editions Quae/Belin), qui est un réalité un « traité d’innovation » hybridé avec une introduction à l’épistémologie : après des considérations sur les rapports entre la science et la technique, des centaines d’ « inventions » culinaires sont organisées, de façon formelle, et une méthode d’invention est proposée.
Ici, le propos est bien plus limité, et plus pratique : je veux répondre à des amis selon qui les scientifiques seraient de purs esprits, un peu inutiles. Et je veux leur répondre que non, les
sciences de la nature ne sont pas de coûteuses « danseuses », mais bien un socle sur lequel s’érige la technique.
Daniel Guinier
Cyberattaques et cyberguerres
Depuis 2014, l'Ukraine connaît des affrontements armés dans l'est du pays. Ils opposent Kiev à des séparatistes dont le Kremlin est considéré comme le soutien militaire et financier. Tandis que des forces militaires russes sont massées en grand nombre à la frontière de l'Ukraine, des consultations ont eu lieu dans l’espoir de trouver une solution diplomatique. Une désescalade significative et vérifiable était attendue comme un signal positif, après que Vladimir Poutine ait assuré de ne pas vouloir la guerre, en annonçant le 15 février 2022 le retrait d'une partie des troupes russes stationnées à la frontière, ce que les Occidentaux n'ont pas observé dans les faits. A contrario, il a été vu la mobilisation générale décrétée par les dirigeants des territoires pro-russes, observé des accusations et des provocations mutuelles, avec des bombardements et des échanges de tirs, alimentant ainsi les craintes d'une invasion russe en Ukraine, et pas seulement dans ces territoires. Ce pressentiment était fondé.
Robert Anton et Christian Busser
La Pharmacie du Bon Dieu : à la découverte des plantes d'Alsace et des Vosges
Que diriez-vous d’une promenade bucolique au cœur de notre patrimoine naturel alsacien-vosgien, à la découverte de plantes qui peuvent nous enchanter par leur beauté, qui peuvent nous soigner (ou
éventuellement nous faire mourir) et pour lesquelles les traditions thérapeutiques du passé se mêlent à la science actuelle ?
Suivons deux guides éclairés : Robert Anton, professeur émérite de l’Université de Strasbourg, membre de l’Académie d’Alsace, des Académies nationales de Médecine et de Pharmacie, et Christian
Busser, docteur en pharmacie, docteur en ethnologie.
Puisque Voltaire a écrit « comme le secret d’ennuyer est celui de tout dire », nous ne dirons pas tout ! Alors en route…
Daniel Guinier et le Metavers
Le concept de métavers apparaissait déjà dans la littérature il y a près de 60 ans. En quelques décennies il a emprunté des technologies dont il bénéficie maintenant de la convergence. Depuis l'annonce récente de la mutation de Facebook en Meta, en guise de prodome par son PDG Marc Zuckerberg, les GAFAM deviennent de fait les GAMAM, et après sa présentation vidéo en réalité virtuelle augmentée impressionnante pour les néophytes mais pas nouvelle, le terme "métavers" est sur toutes les lèvres.
Christian Busser et Robert Anton : Médecine populaire et traditionnelle en Alsace
L’isolement relatif des villes et villages jusque dans les années de la première guerre mondiale, ainsi que l’absence de moyens de locomotion rapides a favorisé l’utilisation traditionnelle des plantes médicinales et de nombreuses préparations complexes issues des 3 règnes.
Theo Graber : France, Allemagne, Alsace : À la croisée des chemins de mémoire
La Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du Ministère des Armées vient de faire paraître un numéro hors-série, « La mémoire en France et en Allemagne », de sa revue
« Les Chemins de Mémoire ». Pourquoi et comment commémore-t-on des deux côtés du Rhin ? Quelles évolutions souhaitables ? Et en Alsace-Moselle ? Parmi les auteurs, notre
consœur Frédérique Neaud-Dufour, ancienne directrice du Struthof.
La suite à lire ici
Hervé This : Existe-t-il une cuisine alsacienne ?
Existe-t-il une cuisine alsacienne ? La réponse à la question est évidemment oui : une cuisine est alsacienne quand elle est faite en Alsace, où ailleurs qu’en Alsace par des Alsaciens, ou encore quand d'autre que les Alsaciens reproduisent, en Alsace ou non, des recettes des deux catégories précédentes… Mais chimiste, c’est donc la chimie de cette « cuisine alsacienne » qui m'intéresse.
Théo Graber: Chateaubriand à La Vallée-aux-Loups
Au cours de plus de quarante années professionnelles à Paris et en Ile-de-France, il m'a été donné, de nombreuses fois, d'être convié aux Heures Romantiques et aux Prix d'Histoire de La Vallée-aux-Loups ; et chacune de ces belles invitations m'a procuré de grands contentements.
Daniel Guinier : Quand la blockchain consomme plus d'énergie que certains pays...
Les livres-registres sont indispensables pour la consignation et la validation des transactions et des actes. Avec la dématérialisation, ils nécessitaient des calculs et des vérifications centralisés, ainsi que le recours à un tiers de confiance, puis ont évolué au gré de systèmes à présent distribués. La désintermédiation repose alors sur la confiance partagée
Daniel Guinier : Technologie 5G ; aspects connexes essentiels
Le progrès ne se mesure pas à l'addition de technologies, mais au sens apporté par chacune. Une société équitable ne découle pas uniquement d'un juste avantage, mais résulte d'un bien commun utile et d'un risque partagés. Notre confrère Daniel Guinier, ancien expert près la Cour pénale internationale de La Haye, chargé d'enseignement universitaire et conférencier, plaide notamment pour de nouvelles priorités à la recherche en France et en Europe.
Daniel Guinier : Le temps qui passe...
Bien des questions se sont posées au travers des siècles à propos du temps, de sa nature, de son écoulement, mais également de l'illusion ou de la réalité qui s'en dégage. Daniel Guinier, ancien expert près la Cour pénale internationale de La Haye, membre de l’Académie d’Alsace, examine l'évolution du concept et les réponses apportées, notamment à propos de la perception humaine du temps qui passe. Alors que l’actualité crée un double constat paradoxal, entre le temps suspendu, confiné, d’un côté, et le temps qui s’accélère, s’affole, de l’autre, voilà une stimulante mise en perspective.
Jean Richert : Un témoignage de l’incroyable imagination créatrice de l’être dans des temps difficiles: Le Manuscrit
philosophique de Werner Heisenberg
Une précieuse lecture pour nos temps troublés : « Le manuscrit de 1942 » (Ed. Allia, 2003) du physicien Werner Heisenberg (1901-1976), un des pères de la physique quantique. Il invite à une exigeante réflexion sur la responsabilité individuelle, à la lumière de ses doutes au cœur de la guerre, alors qu’il sentait l’Allemagne sur le point de tomber et que les autorités lui demandaient de mettre au point la bombe atomique.
Théo Graber : Au nom de tous nos liens
Dans l'accélération continue de la mutation du monde, nous avons besoin des livres comme du silence et de la hauteur des cathédrales, affirme Théo Graber, membre du comité directeur de l’Académie d’Alsace. De leur prééminence, nous dit-il dans ce texte très personnel, dépend notre avenir commun.
Marie-Laure Freyburger : LE ou LA covid ?
Professeur émérite de grec ancien à l’Université de Haute Alsace, membre du comité directeur de l’Académie d’Alsace, Marie-Laure Freyburger nous éclaire sur un point qui fait débat : faut-il dire « le » ou « la » covid19 ? Elle réagit à un texte publié sur le site de l’Académie Française. Un billet d’humeur linguistique et académique.
Bernard Reumaux : « Des livres pour vivre libres ! »
Président de l’Académie d’Alsace, directeur éditorial de la collection « La grâce d’une cathédrale » (qui vient de faire paraître les volumes sur Angers et Autun), il réagit aux mesures de fermeture des librairies, commerce jugé « non essentiel » par le gouvernement dans le cadre du deuxième confinement du pays. Et propose de faire de Strasbourg la « capitale européenne du livre ». Ce texte a été adressé le 2 novembre 2020 à la presse alsacienne.
Hervé This vo Kientza : Profitons de ces temps troublés pour rénover les études
Avec le confinement, l'ensemble du système de formation a cherché des solutions pour assurer la continuité des cursus. Parfois, c'était seulement une "rustine", mais, parfois aussi, des innovations plus profondes ont été proposées . On peut espérer que le meilleur des usages nouveaux sera conservé, car le besoin de rénover les études était criant, depuis des décennies.
Daniel Guinier : Covid-19 et humanisme
Problématique et réponse des lumières face à une crise majeure.
"Face à une pandémie annoncée et à la crise suivante…", nous avions alerté en 2009 sur la résurgence des crises sanitaires, laissant présager celle que nous connaissons, mais sans en prévoir ni le moment, ni la forme, ni les conséquences. Nous avions indiqué à ce propos : "L'incertitude et la difficulté de prévision sont d'autant plus grandes que l'humanité est dans une phase critique où s'accumulent des crises de nature et de niveau différents, alors que les grands systèmes sont peu diversifiés et interconnectés au niveau mondial, introduisant ainsi la possibilité de crise systémique".
Michel Zink : Plaidoyer pour les Académies en réaction au New York Times
René Woltz : Sur les modèles universitaires en Europe et leur héritage en Alsace
Le modèle de l'Université médiévale avec l'enseignement scolastique était, pour l'essentiel, influent en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand la
Révolution française a bouleversé l'Europe. Assujetti à l'Eglise catholique jusqu'au XVe siècle, le modèle scolastique s'ouvrait progressivement au mouvement émancipateur de
l'humanisme et au mouvement "sécularisant" des Lumières tout en subissant les secousses des conflits religieux de la Réforme.
Telecharger le texte entier ci-dessous
Jacques Streith : L'affaire Dreyfus
La victoire de la vérité sur la Raison d’État et le mensonge. Le monument érigé à Mulhouse à l’occasion du cent-dixième anniversaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus par la Cour de cassation.
Marie-Laure Freyburger : Développement de l'humanisme dans le Rhin supérieur
Le Rhin Supérieur a toujours été un lieu de passage et de brassages des idées. Aux XVe et XVIe siècles, c'est le mouvement humaniste qui, né en Italie dès le XIVe siècle, s'est développé après la prise de Constantinople par les Turcs, et s'est rapidement répandu vers l'Europe du Nord. Bénéficiant de l'invention de l'imprimerie, les érudits prônent un retour aux sources antiques, paiënnes et chrétiennes, et diffusent leurs idées nouvelles en s'affranchissant des carcans de la scolastique médiévale.
Lionel Compte : Platon, le Dalaï-lama et les neurosciences
Il y a quelques semaines s’est tenu à l’Université de Strasbourg un colloque avec la participation du dalaï-lama sur le thème « Méditation, conscience et neurosciences ». Platon n’aurait assurément pas manqué d’organiser une telle rencontre au sein de son Académie. En effet, par son allégorie de la caverne, Platon aborde la difficulté et le travail nécessaire – la dialectique - pour passer d’un monde constitué des reflets de la réalité au monde de la réalité elle-même.
Cette démarche ressemble fort à celle de la méditation qui vise, en tout cas dans son acception bouddhiste, au passage de l’être « endormi » et dans l’ignorance à l’être « éveillé », libéré de tous les conditionnements. Mais que viennent faire les neurosciences dans cet environnement philosophique ?