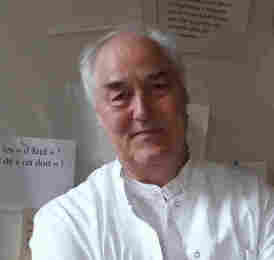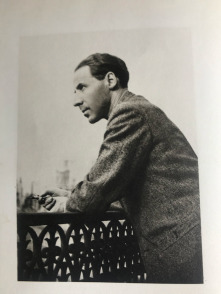Une cuisine alsacienne ?
Existe-t-il une cuisine alsacienne ?
La réponse à la question est évidemment oui : une cuisine est alsacienne quand elle est faite en Alsace, où ailleurs qu’en Alsace par des Alsaciens, ou encore quand d'autre que les Alsaciens reproduisent, en Alsace ou non, des recettes des deux catégories précédentes…
Mais les considérations de ce type relèvent plutôt de ces entretiens regroupés dans l’« En quête d'Alsace » du Conseil culturel d’Alsace, et elles ne sont pas l’apanage de la
physico-chimie, cette science dont j’essaie d’être un bon spécialiste.
Chimiste, c’est donc la chimie de cette « cuisine alsacienne » qui m'intéresse. Plus exactement, c’est la question de la cuisine alsacienne considérée par ma discipline, la
« gastronomie moléculaire », qui m’intéresse, ce qui me conduit à immédiatement alerter sur une confusion fréquente : si la « gastronomie moléculaire » est une discipline
scientifique, elle ne se confond pas avec la « cuisine moléculaire », qui est une rénovation que j’avais proposée pour la cuisine, et qui consiste à utiliser, pour cuisiner, des matériels
et des méthodes modernes, rationnels, importés des laboratoires. Les dénominations que j’ai choisies sont justes : « cuisine » signifie préparer des mets, tandis que
« gastronomie » signifie non pas cuisine d’apparat, mais connaissance raisonnée de ce qui se rapporte à l’être humain en tant qu’il se nourrit, disait Jean-Anthelme Brillat-Savarin.
Pour en revenir à la cuisine alsacienne, il y a beaucoup analyser si l’on veut identifier des spécificités, mais on pourrait commencer par considérer des plats un peu emblématiques : la
choucroute garnie, le coq au riesling, le Strudel aux quetsches, le pot-au-feu alsacien, le Baeckahofa, le Kugelhopf...
Y a-t-il une particularité physico-chimique dans tous ces plats ? Un coq au riesling est-il autre chose qu'un coq au vin ? Un Kugelhopf est-il autre chose qu'une brioche avec des raisins secs
regonflés ? Un Baeckahofa est-il vraiment différent d'une potée ?
On se souviendra d’abord, pour analyser cette question, que la cuisine, c'est de la technique, de l'art et du lien social (de l’ « amour »).
La technique est simple et il faudrait une analyse ethnologique approfondie pour voir si des pratiques techniques originales sont mises en œuvre en Alsace.
Pour la question « artistique », c’est le « goût », qui est en jeu, et il dépend à la fois de celui des ingrédients et des transformations mises en œuvre. Le choix des ingrédients
est essentiel, comme la comparaison avec la peinture le fait comprendre : un bleu particulier, tel bleu outremer, ne fait pas la même œuvre qu’un autre bleu, tel un bleu de Prusse.
En la question sociale est si essentielle que nous ne l’esquiverons pas, même dans un texte écrit par un chimiste.
Pour analyser la question, il faut… de l’analyse
Pour la question technique, commençons simplement, si l’on peut dire, par les ingrédients. Ce sont d’abord des végétaux et des animaux particulier, parfois reconnus par des indications d’origine.
La vache vosgienne est typique, les variétés végétales le sont parfois aussi (pensons à la mirabelle, la quetsche), et les sols sont particuliers, d’où des conditions de croissance
particulière.
Puis, pour certaines préparations qui entre dans la composition des mets, tels les vins, les bières, les laits, crèmes ou fromages, les charcuteries, les transformations sont de nature fermentaire,
et, là, des études ont déjà été faites. Par exemple, mon collègue Jean Baptiste Coulon, de l'INRAE de Theix, près de Clermont-Ferrand, a parfaitement établi que le reblochon de plaine est
sensoriellement et moléculairement différent du reblochon de montagne ; mieux même, les reblochons de montagne de l’adret diffèrent de ceux de l’ubac… parce que les plantes ne sont pas les
mêmes, que les vaches ne consomment pas la même nourriture, et que le lait se ressent de l’alimentation.
Pour d’autres produits, il y a des différences spectaculaires : j’ai été étonné, un jour, de voir de la crème alsacienne foisonner en 27 secondes seulement ! Et le lard est produit avec un
fumage spécifique, sans compter que les recettes de charcuterie sont originales : pensons à la Knack, par exemple.
Enfin les micro-organismes de fermentation sont essentiels. De même que le munster n'est pas semblable à du camembert ou à de l’époisses, même si le lait était identique, les bières, les vins, les
charcuteries, les choucroutes, etc. diffèrent. Par exemple, pour les bières ensemencées par des micro-organismes sauvages (on expose le brassin au vent qui passe, en ouvrant le toit de la brasserie),
une étude a montré que les résultats étaient parfaitement différents de part et d’autre d’un col, à ingrédients et procédés constants, parce que le vent ne déposait pas les mêmes micro-organismes. Là
encore, une différence gustative et moléculaire !
Mais la réponse ne porte, encore, que sur les ingrédients de la cuisine, pas la cuisine elle-même. Considérons le vin, dans un coq au riesling, par exemple. Évidemment un coq au Riesling n’est pas un
coq au pinot de Bourgogne, mais se distingue-t-il d’un coq au chardonnay ? Ou d’un coq au Riesling d’Allemagne ou d’Australie ? Certes, un Riesling du Schlossberg, grand cru de Riesling, se
distingue sensoriellement et analytiquement d’un riesling d’Australie, par exemple, mais, dans le plat final, ce n’est plus du Riesling : il a été cuit, transformé, avec évaporation d’eau,
d’éthanol, entraînement à la vapeur de composés odorants. Bien sûr, une saine pratique culinaire sait ajouter un peu de vin cru dans la sauce, en fin de cuisson, pour lui redonner de la vivacité,
mais est-ce suffisant pour distinguer le plat ? Il faudra une dégustation à l’aveugle pour résoudre la question.
De la recherche confiée au milieu scolaire
Là où la question se complique, c’est que les pratiques varient : il y a autant de coqs au Riesling d’Alsace que de cuisinières et de cuisiniers, et c’est donc une sorte d’espace des coqs au
riesling (alsaciens, donc) qu’il faudra comparer à des coqs au vin d’ailleurs. Les différentes préparations seront représentées par des nuages de points, dans un espace multidimensionnel, et il
faudra donc mettre en œuvre des méthodes « chimiométriques » (statistiques, sur des données d’analyse chimique ) pour trancher.
Pour autant, les recettes peuvent déjà être analysées, après qu’on les aura colligées. Les travaux de l’OLCA, de ce point de vue, sont essentiels, mais ne pourrions-nous pas faire, en Alsace, ce que
j’ai initié au Liban, par exemple ? Pourquoi ne pas créer des programmes de recherche associant écoles, collèges et lycées, pour que les enfants soient missionnés pour rapporter dans leur classe
des recettes, aussi variées que possibles, qui feront le corpus qu’on analysera ensuite ?
Mieux encore, il y a sans doute lieu de consigner non seulement les recettes, mais aussi les tours de main, et, plus généralement, toutes ces informations que j’ai regroupées sous la dénomination de
« précisions culinaires ». En effet, une recette, c’est d’abord une définition, qui peut être donnée sous une forme succincte, ou protocolaire, ou narrative. Par exemple, pour une compote
de poires, la définition serait : des poires, de l’eau, du sucre, on chauffe. Tout ce qui vient en plus, du point de vue technique, relève des « précisions culinaires », tandis que
subsiste une « tierce partie », qui peut être un commentaire social, artistique, etc.
Les précisions culinaires (par exemple : « il faut cuire les Kugelhopfs dans des moules en terre cuite », ou « ajouter du jus de citron à la compote la conserve blanche tandis que
cuivre dans de l’étain la rend rouge ») sont des joyaux culturels, mais, aussi, des portes d’entrée vers des innovations culinaires, à conditions d’être testées, et cela peut se faire utilement
dans les établissement d’enseignement de l’hôtellerie-restauration, mais pourquoi pas, aussi, dans les établissements d’enseignement général, réunissant des professeurs d’histoire, de géographie, de
sciences de la nature...
Ne pas se tromper de cible : le bon, c’est le beau à manger
Pour la question artistique, la chimie a sans doute assez peu à dire, et c’est désolant, parce que nous avons dit combien la question est essentielle : le « bon », c’est le beau à
manger. L’analyse est esthétique, non pas au sens de l’aspect visuel, mais de l’aspect gustatif. Et là, il faut une grande expérience des cuisines du monde pour -éventuellement- distinguer la cuisine
alsacienne. Et la distinguer dans un « paysage culinaire » en changement constant. Le remarquable livre de notre confrère Georges Bischoff (Le ventre de l’Alsace, Nuée bleue) montre combien
prudent nous devons être dans nos jugements, combien nous devons éviter des fantasmes à propos de ce que croyons -ou voulons- être une cuisine alsacienne. On a bien raison de dire qu’un homme qui ne
connaît que sa génération est un enfant, et nous avons besoin de sources fiables pour nous y repérer. D’ailleurs, quelle Alsace ? Le Ried ? Le Sundgau, qui était naguère si pauvre ?
Les environs de Colmar ? Les contreforts des Vosges ?
Au-delà des nécessaires rigueurs et prudence méthodologiques, il faut quand même reconnaître que la nature éminemment artistique de la cuisine implique en réalité la variation, chacun y mettant sa
patte, en quelque sorte. J’en prends pour indication, voire preuve, le résultat d’explorations récentes de la « sauce allemande » dans les livres de cuisine français du passé (en se
souvenant que, jadis, l’Alsace n’était pas française!)
La plus ancienne mention de l’Allemagne que je trouve dans un livre de cuisine est donnée par Nicolas de Bonnefons, en 1655, et à propos de salsifis. On y trouve que cette « sauce
tournée », ou « sauce d’Allemagne », se prépare « en mettant du beurre dans un plat, avec du sel & de la muscade & un peu de vin-aigre ; puis mettre un plat sur le
rechaud, & à mesure que le beurre fondra, tourner continuellement avec une cueiller tant que tout soit fondu ; & aprés le verser dessus les salsifis, & servir promptement, d’autant
que si on les laissoit davantage sur le feu, ou que l’on les rechauffast le beurre s’affiniroit ou s’éclairciroit comme de l’huile ; Vous y pourrez aussi adjouster la cresme douce ainsi qu’aux
carottes. » Cette recette propose donc une « émulsion », à savoir une dispersion un peu stabilisée de matière grasse (le beurre fondu) dans une phase aqueuse. Bref, c’est un peu
comme dans un beurre blanc ! Et la terminologie de « sauce tournée » ne signifie pas que la sauce est tournée, au sens d’émulsion déstabilisée, mais seulement qu’il faut la
tourner pour faire l’émulsion du beurre fondu dans la phase aqueuse, à savoir le vinaigre.
En 1722, François Massialot évoque une sauce d’Allemagne, par exemple pour un brochet : le poisson est cuit à l’eau, puis on le sert avec une sauce faite de vin blanc, câpres hachées, anchois,
thym, fines herbes et champignons hachés, plus des truffes et des morilles ; on lie avec beurre et parmesan. Cette fois, le goût change du tout au tout, même si l’on reste dans le même
type physico-chimique.
Le Nouveau cuisinier royal, en 1729, ne dit pas autre chose, sauf que, à nouveau, l’auteur recopie en ajoutant. Pour le brochet à la sauce d' Allemagne, il précise d’ « habiller bien
proprement » le poisson, de le cuire incomplètement dans l’eau, puis de l’écailler avant de le mettre dans une casserole avec du vin blanc, des câpres hachées, des anchois, des fines
herbes et des champignons hachés. On porte à frémissement, puis on y ajoute du beurre pour lier, avec du parmesan.
En 1758, François Marin, dans les Les dons de Comus, revient sur la « sauce à l’Allemande », mais il lui donne plus de goût : il commence par sauter dans du beurre ou du lard
fondu des champignons avec persil, ciboules, échalotes. Puis il ajoute des tranches d'oignon, on singe avant de mouiller avec du blond de veau, un verre de vin, du sel, du poivre. Et il
finit avec parmesan et vinaigre. Cette fois, l’ajout de farine fait une liaison différente, parce que les grains d’amidon de la farine s’empèsent lors de la cuisson, formant ce que les
physico-chimistes nomment une « suspension de micro-gels », émulsionnée certes.
Au 19e siècle, Viard revient sur la « sauce allemande », qu’il propose de faire avec un velouté lié avec des jaunes d’œuf, du beurre, poivre et sel. Et Marie Antoine Carême d’ajouter, à la
même époque, à propos d’une « allemande » :
« Quant à la sauce allemande, elle fut sans doute importée chez nous après quelque grande noce ; et nous conservons encore avec respect le nom de cette sauce blonde, que nous avons rendue aussi
veloutée que parfaite. Par conséquent, nous pouvons dire, sans craindre d'être taxés de vanité, que ces sauces étrangères sont tellement changées dans leurs préparations, qu'elles sont depuis
long-temps toutes françaises. Honneur soit donc rendu aux cuisiniers du dix-huitième siècle et à ceux du siècle présent, qui ont eu assez de bon sens pour maintenir les noms de ces sauces
nationalisées ! »
C’est un argument d’autorité, d’autant plus contestable qu’il commence par un « sans doute » : Carême n’a pas fait l’étude historique, mais il est (notoirement) grandiloquent et
péremptoire.
Gouffé, peu après, distingue une liaison à l’allemande et une allemande. Pour la liaison dite à son époque « à l' Allemande », c’était de la farine détendue dans de l'eau, lait
ou bouillon, suivant le genre d'opérations pour lequel on l'employait ; on passait à travers la passoire dite chinois, puis on versait d'une main dans les mets que l'on voulait lier, en agitant
de l'autre avec la cuiller. En revanche, pour sa recette d’allemande, il fallait réduire de l’essence de champignons, de l’essence de volaille et du velouté gras, et lier avec des œufs et du
beurre,
En 1889, Joseph Favre ajoute des commentaire dans son Dictionnaire universel de la cuisine, à propos de l’allemande :
« Sauce composée de farine passée au beurre sans être roussie et mouillée avec du bouillon de viande blanche, telle que veau, dinde, poulet etc., que l'on fait réduire en remuant et qu'on lie
ensuite avec des jaunes d'œufs. Les qualités essentielles que doit comporter cette sauce sont d'être blanche et très réduite. »
Et, peu après, le Guide culinaire donne quelque chose de si différent que la dénomination est alors usurpée. L’allemande serait un velouté lié et crémé, avec champignons, fond blanc,
velouté, jus de citron ; après réduction, on ajouterait de la crème et du beurre. Certes, une telle préparation n’est pas mauvaise, mais ce n’est pas une allemande : évitons le Guide
culinaire pour l’enseignement !
Ainsi, finalement, l’analyse conduit à distinguer des sauces allemandes différentes
- des « sauces d’Allemagne » : une émulsion qui se fait en battant, tout en chauffant, du beurre, avec sel, muscade, vinaigre
- des « sauces à l’allemande » : champignons, oignons, singés, puis additionnés de parmesan et de vinaigre
- des « sauces allemandes » : un velouté réduit, lié avec des jaunes et du beurre, éventuellement crémé.
Cette question des sauces « allemandes » est un exemple de ce que l’on peut faire, quand on associe une étude historique et une étude physico-chimique : l’analyse permet de mieux
suivre des variations ou des constances qu’avec les classifications culinaires anciennes, et erronées.
La cuisine, c’est d’abord de l’ « amour », en tout cas du lien social
Enfin il y a la question sociale, et là, il est vrai que la culture alsacienne fait rester les gens à table pendant des heures, mangeant et buvant. Nombre d’Alsaciens citent le voyage en Italie de
Montaigne, mais c’est un fait que ceux qui viennent de l'Intérieur sont frappés par cette insistance culinaire de l'Alsace… qui est d'ailleurs une des raisons de leur venue. D’ailleurs, moi-même qui
suis en exil à Paris une proportion bien trop grande de mon temps, je m’émerveille de la manière de vivre de mes amis d’Alsace, pour qui la moindre réunion d’association conduit à boire et à
manger : inimaginable en région parisienne !
Pour l’analyse des spécificités sociales de la cuisine alsacienne, il n'est plus question de composés ou de micro-organismes, mais d'habitude, de culture, de tradition, de volonté de faire groupe, de
se distinguer, avec ce paradoxe que l'être humain est une espèce sociale et qu'il y a une récompense biologique à ce que les humains soient regroupés… mais aussi, il y a des tendances antagonistes,
tout aussi biologiquement fondées, qui conduisent à des groupements. D’ailleurs, on ne saurait discuter la composante sociale de la cuisine alsacienne sans souligner le nombre incroyable
d'associations dans les villages : les sapeurs-pompiers, le conseil de fabrique, le tir… Certes, la loi spécifique en Alsace sur les associations favorise ces regroupement, mais on
pourrait tout aussi bien dire que si l’Alsace a cette loi, c’est qu’elle l’a voulu si fort qu’elle l’a eue.
Une cuisine alsacienne ? Cela signifie « une culture alsacienne ».