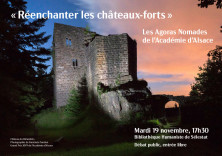Le chaos social et sa dynamique
Daniel Guinier
Expert de justice honoraire, Daniel Guinier est ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye, également chargé d'enseignement universitaire et conférencier
Dans un monde traversé par des tensions profondes, le chaos ne semble plus une idée lointaine. Crises successives, alliances fragilisées, équilibres rompus : les signaux s’accumulent et dessinent
l’hypothèse d’un chaos social. Les théories en esquissent la dynamique, sans en pouvoir fixer l’échéance. Les dirigeants semblent l’ignorer, tandis que réseaux sociaux, sphères d’influence et
d'ingérence amplifient confusion et instabilité. L’auteur plaide pour l’alliance de la vigilance, de l’éthique et de l’imagination collective pour créer une dynamique transformant le désordre à
l’œuvre en un nouvel ordre, garantissant la pérennité des valeurs humaines.
Le chaos trouve son origine dans la mythologie grecque, où il désigne "le commencement confus de toutes choses". Ce terme polysémique résonne à travers les époques, des récits anciens aux sciences
modernes. Chez Hésiode, il incarne l’état primordial d’où naissent les dieux, le cosmos et l’ordre. En cosmologie contemporaine, il renvoie à la création de l’univers. Les théories modernes y
révèlent un ordre dissimulé, où la plus infime variation peut engendrer une multiplicité d’états. Loin d'une simple négation, il apparaît aussi comme une dynamique essentielle, tantôt menaçante,
tantôt féconde, mais toujours porteuse de transformation. Il traverse ainsi les mythes, les savoirs et l’expérience humaine, se manifestant notamment dans les périodes de bouleversements sociaux,
politiques ou économiques.
Le chaos social
Le chaos social ne saurait se réduire à un simple désordre passager. Il incarne la rupture d’un ordre établi, la perte de repères collectifs et l’effondrement des structures censées réguler la vie commune. Il surgit lorsque les institutions apparaissent impuissantes ou illégitimes, ouvrant ainsi la voie à l’imprévisible. Ce phénomène traduit une instabilité profonde, nourrie de fractures sociales, de méfiance généralisée, de violences et de contestations massives.
Comme l’a souligné Michel Foucault (1975), l’ordre repose sur des mécanismes subtils de pouvoir et de surveillance et, lorsque ceux-ci vacillent, la société bascule vers le chaos. Les causes sont multiples et intriquées : inégalités économiques, chômage et précarité, effets de la mondialisation et des mutations technologiques, crises politiques, corruption, autoritarisme ou tensions identitaires. Les médias et les réseaux sociaux accentuent encore ces vulnérabilités, polarisant les opinions, diffusant de fausses informations (fake news), en laissant place aux influenceurs et aux ingérences étrangères.
L’histoire de la France illustre à plusieurs reprises cette ambivalence du chaos. La Révolution de 1789, marquée par des violences extrêmes, déboucha sur une refondation politique majeure. De même, Mai 1968, né dans les universités, se transforma en grèves générales paralysant le pays avant de susciter de profonds changements sociaux. Dans ces deux cas, la période de désordre fut à la fois un signal fort de rupture et un moteur de transformation.
Peter Turchin (2023) propose une lecture historique de ces dynamiques à l’échelle de dix millénaires. Selon lui, toutes les sociétés traversent des cycles alternant stabilité et crise, obéissant à des mécanismes récurrents : appauvrissement des classes populaires, excès d’élites, endettement massif et perte de confiance dans les institutions. Bien que sa démarche, fondée sur des modèles quantitatifs discutables, suscite des controverses, elle éclaire la fragilité des démocraties contemporaines face aux inégalités croissantes et à la montée du populisme. Enfin, il plaide pour des réformes institutionnelles, une redistribution plus équitable, et une participation citoyenne renforcée afin de prévenir les dérives autoritaires.
Le chaos social ne relève donc ni du hasard, ni d’une simple effervescence ou folie collective. À la fois menace et promesse, il constitue un symptôme de désagrégation autant qu’une force transformatrice. En comprendre les mécanismes, c’est mieux saisir les réponses politiques, institutionnelles et sociales qu’il appelle, pour entrevoir la possibilité d’un nouvel équilibre, et avant tout, de sa prévention.
L’imprédictibilité des dynamiques sociales
L’étude des systèmes complexes offre un cadre d’analyse pour comprendre l’imprévisibilité des dynamiques sociales et politiques. Comme nous l'avions déjà souligné en 2002, à propos des systèmes d’information, plusieurs théories se révèlent tout particulièrement pertinentes. Transposées au champ social, bien qu'elles explorent un aspect spécifique, leur articulation conduit à un même constat.
La théorie du chaos, développée par Edward Lorenz (1963), montre qu'un système déterministe peut évoluer de manière radicalement imprédictible. Ce phénomène tient à la sensibilité aux conditions initiales, ou effet papillon, quand de petites variations peuvent transformer profondément le cours d’un système, comme le montre David Ruelle (1981). Transposée au domaine social, une rumeur, un geste ou une déclaration peut déclencher une mobilisation massive… ou passer totalement inaperçue. Le concept d’attracteur étrange illustre la fragilité des trajectoires collectives. Les sociétés, comme les systèmes physiques loin de l’équilibre, évoluent dans un espace de possibles et peuvent bifurquer de manière inattendue selon un phénomène de cascades successives, décrit par Mitchell Feigenbaum (1978). Un événement mineur peut provoquer un soulèvement ou n’avoir aucune conséquence. La théorie du chaos met ainsi en évidence l’imprévisibilité radicale des dynamiques sociales.
La théorie des catastrophes, élaborée par René Thom sur le plan mathématique dans les années 1960, puis présentée sous un angle topologique illustrée par des catastrophes élémentaires par Erik Zeeman (1976), met en lumière les ruptures soudaines dans des systèmes où s’accumulent progressivement des tensions. Les sociétés peuvent ainsi contenir frustrations et contradictions sans qu’aucun signe visible de rupture ne se manifeste, jusqu’au franchissement d’une valeur critique. Ces seuils restent indécelables avant d’être atteints, rendant impossible toute évaluation du moment de l'effondrement. Une révolte ou un soulèvement peut donc survenir à tout moment, tandis que les tensions continuent de croître sans provoquer immédiatement de rupture. Le point précis du basculement demeure invisible, et la catastrophe ne devient lisible qu’a posteriori. La théorie montre ainsi que, bien que la rupture sociale soit possible, son basculement demeure imprédictible.
L'approche par la criticité auto-organisée, introduite par Per Bak et al. (1987), souligne des systèmes en état critique permanent. Dans ceux-ci, une perturbation peut produire des répercutions très variables. La plupart demeurent insignifiantes, tandis que certaines déclenchent des crises majeures. La distribution des événements suit alors une loi de puissance, sans relation proportionnelle entre la cause et l’effet. Les mouvements sociaux semblent alors obéir à des lois comparables à celles des systèmes physiques complexes. Le modèle du tas de sable illustre cette dynamique où chaque grain peut provoquer une avalanche de taille variable. Ceci indique qu’un geste minime peut provoquer un soulèvement. L’aléa et la disproportion des effets des perturbations rendent ainsi toute prédiction du déclenchement d’un mouvement social impossible.
La combinaison de ces trois approches théoriques offre une grille d’analyse globale. Individuellement, la théorie du chaos met en évidence la dépendance aux conditions initiales, la théorie des catastrophes révèle l’existence de seuils critiques indétectables, et la criticité auto-organisée souligne la disproportion entre causes et effets. Ensemble, elles montrent que les mouvements sociaux se développent dans un contexte d’incertitude irréductible, où ordre et désordre s’entrelacent. Toute tentative de prédiction du moment exact où un phénomène d'ampleur inédite se déclenche demeure illusoire. En attendant, la société évolue dans un équilibre fragile, toujours dans l'attente de la prévention le chaos social.
La prévention du chaos social
Concernant l’application de la théorie du chaos aux systèmes d’information, Daniel Guinier (1997) décrit différents régimes dynamiques, - stationnaire, oscillatoire ou chaotique-, dont l’existence dépend à la fois de l’apparition du chaos et des conditions de sa création. Il montre qu’un choix judicieux des valeurs associées aux facteurs, correspondant à l’attracteur étrange, permet d'échapper au caractère erratique du chaos. La société, pour sa part, ne tend ni vers une stabilité parfaite, ni vers une simple répétition des mouvements. Son comportement oscille dans une zone de possibles, où crises et réorganisations se succèdent sans rompre l’ensemble, sauf en cas de rupture radicale. L’attracteur étrange qui la structure, - institutions, normes, ressources, pouvoir, technologies, etc. -, canalise ses trajectoires. Un régime stable, en revanche, limiterait ces oscillations et orienterait le système vers un équilibre relatif ou des cycles prévisibles.
La surveillance institutionnelle modèle les comportements à travers des normes et des mécanismes de contrôle omniprésents. Les troubles sociaux apparaissent lorsque ces dispositifs sont perçus comme excessifs, injustes ou illégitimes. Les citoyens, refusant de se plier à des normes imposées, rompent alors avec l’ordre établi. Le désordre devient un mode de résistance, une manière pour individus et groupes d’affirmer des contre-pouvoirs. Le chaos social n’est donc pas un simple dérèglement, mais le révélateur des tensions profondes qui traversent la modernité. Selon Pierre Bourdieu (1979), les inégalités se reproduisent en grande partie par des mécanismes liés au capital culturel, qui valorise les codes, normes et pratiques des classes supérieures. Les institutions éducatives et les médias participent à cette reproduction en marginalisant les savoirs et comportements des classes populaires, nourrissant ainsi un sentiment durable d’exclusion, d’injustice et de colère.
La prévention du chaos social requiert une action concertée sur plusieurs facteurs. Les institutions devraient pouvoir absorber les tensions et les conflits, tout en offrant de réels moyens d’expression et de participation. La médiation et la justice sociale contribueraient à réduire les inégalités et le sentiment d’exclusion, tandis qu’une information et une communication de qualité limiteraient la propagation des rumeurs et favoriseraient un débat éclairé. Les cultures et normes collectives gagneraient à produire des récits et des rituels inclusifs, capables de canaliser les tensions de manière constructive. Il importe aussi de prendre en compte les causes évoquées précédemment et les mécanismes identifiés par Peter Turchin (2023). Enfin, le rythme des politiques publiques devrait être ajusté : ni trop lent, pour éviter la frustration, ni trop rapide, afin de prévenir les effets pervers. De telles dispositions permettraient d’amortir les crises naissantes, de contenir les boucles de rétroaction incontrôlées et de renforcer les mécanismes régulateurs, transformant ainsi le chaos social en une complexité maîtrisable. Une telle perspective suppose toutefois l’existence d’institutions et de politiques robustes admises comme légitimes.
Le double jeu des réseaux sociaux
Dan Braha (2024) montre que l’agitation sociale fonctionne comme un système complexe régi par des mécanismes universels similaires à ceux des systèmes physiques complexes, soumis à des transitions de phase marquées par des réorganisations soudaines. Il met en évidence des dynamiques mesurables où les mobilisations se propagent par les réseaux sociaux et tendent à se regrouper. Les mouvements obéissent à une logique de loi de puissance où de petites protestations coexistent avec de vastes mobilisations annonciatrices de ruptures. Chaque épisode en alimente d’autres, une dynamique renforcée par les réseaux sociaux qui, via les chambres d’écho, transforment les frustrations individuelles en contestations virales. En favorisant des structures décentralisées et horizontales, ces plateformes catalysent l’alternance entre phases de stabilité et de turbulence.
Les technologies numériques, et en particulier les réseaux sociaux, occupent donc une place centrale dans l’émergence du chaos social. Ils agissent à la fois comme déclencheurs et comme amplificateurs de dynamiques collectives susceptibles de bouleverser l’ordre établi.
D’une part, les réseaux sociaux favorisent l’initiation des mobilisations en rendant possible une diffusion instantanée et massive de l’information. Une image, une vidéo ou un témoignage peut en quelques heures atteindre des millions de personnes, suscitant une indignation partagée et catalysant des mouvements de protestation. Parallèlement, ces plateformes offrent des outils de mobilisation et d’organisation : création d’événements, signatures de pétitions, coordination de manifestations. Elles donnent également une visibilité accrue aux voix marginalisées, permettant à des expériences et revendications ignorées par les médias traditionnels de se transformer en causes collectives.
D’autre part, ils participent à l’amplification des tensions. Le fonctionnement algorithmique tend à enfermer les utilisateurs dans des chambres d’écho. C'est ainsi que les idées, opinions et informations sont répétées et amplifiées, souvent sans vérification ou confrontation avec différents points de vue. À cela s’ajoute la circulation rapide de désinformation et de rumeurs, et les ingérences étrangères qui nourrissent la méfiance et peuvent déclencher des paniques ou des violences. Les débats en ligne, souvent marqués par des prises de position extrêmes, accentuent la polarisation sociale et rendent plus difficiles les compromis. De plus, la dynamique émotionnelle propre à ces plateformes, où la colère et la peur se propagent de manière virale, favorise une contagion émotionnelle susceptible d’entraîner une escalade conflictuelle. Enfin, l’usage des réseaux à des fins de surveillance et de répression par les autorités peut, loin d’apaiser les tensions, engendrer de nouvelles formes de résistance et contribuer à l’intensification du chaos social.
Ainsi, loin de constituer de simples canaux d’information, les réseaux sociaux apparaissent comme des acteurs structurants des mobilisations contemporaines, capables de transformer des frustrations individuelles en dynamiques collectives de grande ampleur. Leur rôle ambivalent – catalyseur d’expression citoyenne et vecteur de division – les place au cœur des analyses sur l’instabilité sociale dans les sociétés numériques, correspondant au paradoxe d'alignement dans l'IA et les réseaux sociaux décrit dans Daniel Guinier (2025).
Les deux faces de l'intelligence artificielle (IA)
L'IA s’érige aujourd’hui comme une technologie capable d'aider à remodeler les équilibres sociaux, mais son rapport au chaos reste profondément ambigu. L’illusion de pouvoir prédire les mouvements collectifs nourrit l’espoir d’une direction vers un ordre maîtrisé.
L’IA prédictive, en scrutant d’innombrables données du Big Data, promet d’anticiper les crises, d’apaiser les déséquilibres économiques ou migratoires. Elle se présente aux gouvernants comme un outil de pacification, un rempart contre les convulsions de la société. Pourtant, cette promesse contient le germe du désordre qu’elle prétend conjurer. En réduisant les individus à des données statistiques, elle installe une logique de contrôle et d’ingénierie sociale où la liberté s’étiole. Ses biais reproduisent et amplifient les inégalités, nourrissant rancunes et fractures. Loin de dissiper la venue du chaos, elle risque au contraire de le rigidifier, transformant l’instabilité humaine en un système algorithmique de surveillance froide et impersonnelle.
L’IA générative, en libérant un flot créatif de toute nature sans précédent, multiplie les récits, ouvre des horizons d’expression et rapproche des communautés. Mais, cette même puissance devient un facteur du chaos social. La désinformation, les discours manipulés (deepfakes) et la confusion entre vrai et faux fissurent la confiance collective. Le lien symbolique qui maintient la société vacille quand la parole publique se noie dans l'étendue des simulacres. Le désordre n’est plus seulement matériel, il devient cognitif, fragilisant jusqu’aux fondements de la cohésion politique et sociale.
Ainsi, l’IA n’est pas un simple outil, elle est un agent actif du chaos. Son influence appelle une éthique contraignante. L'IA prédictive impose de repenser justice et responsabilité, tandis que l'IA générative oblige à protéger vérité et dignité. Sans régulation, les technologies d'IA risquent de substituer au chaos des sociétés humaines un chaos artificiel, plus diffus et plus dangereux, enveloppé dans une rationalité algorithmique. L’IA peut donc être à la fois un instrument de cohésion, et un catalyseur de fractures.
Conclusion
La société évolue dans un équilibre toujours précaire, menacé par le chaos social. Les crises successives révèlent les fractures identitaires, les inégalités persistantes et les injustices structurelles, tout en mettant en évidence l’incapacité des institutions à y répondre. Ces signaux d’alarme rappellent qu’un point de bascule ne peut être écarté.
Si l’échéance du chaos social demeure théoriquement imprévisible, la prévention d’un effondrement reste possible. Elle suppose toutefois des institutions solides et légitimes, une régulation rigoureuse des technologies et de leurs usages, une protection efficace contre les ingérences extérieures, ainsi qu’un dialogue social permanent. Elle requiert également des acteurs institutionnels qu’ils assument pleinement leurs responsabilités, en s’accordant pour agir en conscience, dans le respect de l’intérêt général. Face à ces incertitudes, seule l’alliance de la vigilance, de l’éthique et de l’imagination collective peut transformer le désordre en un nouvel ordre, garantissant la pérennité des valeurs humaines et préservant la société de toute dérive autoritaire.
Références
Bak P et al. 1987. Self-Organized Criticality: An Explanation of Flicker Noise. Physical Review Letters, 59(4), 381–384.
Bourdieu P. 1979. La distinction – Critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, 670 p.
Braha D. 2024. Phase transitions of civil unrest across countries and time, Nature partner journals Complexity, 1(1). https://doi.org/10.1038/s44260-024-00001-3
Feigenbaum MJ. 1978. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations, Journal of Statistical Physics, 19(1) 25–52.
Foucault M. 1975. Surveiller et punir. Gallimard, 352 p.
Guinier D. 1997. Application de la théorie du chaos au management du développement de la sécurité. 9ème Symposium annuel CITSS, GoC/CSE-CST, Ottawa, mai, 383–400.
Guinier D. 2002. Systèmes d'information : état critique et désastre – Dispositions essentielles mises en évidence par les apports théoriques. Expertises, 263, 341–344.
Guinier D. 2025. Le paradoxe d'alignement dans l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, Expertises, 514, 28–31.
Lorenz EN. 1963. Deterministic non periodic flow. Journal Atmospheric Sciences, vol. 20, pp. 130–141.
Ruelle DP. 1981. Small random perturbations of dynamical systems and the definition of attractors. Communications in Mathematical Physics, 82, 137–151.
Turchin, Peter (2023) : Le Chaos qui vient – Élites, contre-élites, et la voie de la désintégration politique. Le Cherche Midi, 448 p.
Zeeman EC. 1976. Catastrophe Theory, Scientific American, 234, 65–83.