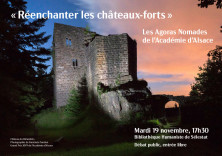L’incorporation de force, crime de guerre ou crime contre l’humanité ?
Nicolas Mengus,
Historien, spécialiste du Moyen Âge et des Incorporés de force
Juin 1940: l’Alsace et la Moselle, provinces françaises, sont annexées de fait au IIIe Reich national-socialiste. Du jour au lendemain, les habitants qui n’avaient pas été expulsés (francophiles, hauts fonctionnaires, Français de l’Intérieur, communistes, juifs, tsiganes…) ont été soumis aux lois nazies, ont été contraints de parler allemand et de bannir tout ce qui pouvait rappeler leur passé tricolore. Cela est contraire aux conventions de La Haye (1899, 1907) et d’armistice du 22 juin 1940. Il s’agit d’un crime contre la paix.
Outre l’adhésion « librement contrainte » à des associations nazies, celle aux Jeunesses hitlériennes devient rapidement obligatoire pour les jeunes. Cette organisation paramilitaire est l’antichambre au Reichsarbeitsdienst (Service du travail du Reich, à ne pas confondre avec le STO en France occupée). Pour les jeunes hommes, c’est une véritable préparation militaire en vue de leur incorporation dans l’armée allemande (Wehrmacht et Waffen-SS) ; notons que ceux qui avaient déjà été soldats français en 39-40 en étaient dispensés.
Pour les jeunes femmes, il s’agit le plus souvent de remplacer les hommes partis au front dans les fermes et les usines. Avec l’évolution désastreuse de la guerre pour le Reich, elles se voient astreintes au Kriegshilfsdienst (Service auxiliaire de guerre) et sont intégrées à l’armée.
Le service militaire obligatoire est introduit en Alsace et en Moselle fin août 1942, ce qui, au regard des conventions, est illégal et constitue un viol de la conscience patriotique de toute une population. Avant cette date, seuls les volontaires pouvaient être enrôlés. En effet, les lois allemandes sur le service militaire interdisaient l’incorporation d’étrangers par voie d’appel. Mais, les Français annexés ne sont-ils pas considérés comme des Volksdeutsche, comme appartenant au peuple allemand, donc à la race germanique, dès 1940 ? Aussi, pour se mettre en conformité avec la loi, les nazis décident de leur octroyer la nationalité allemande – à titre révocable (auf Widerruf) – au moment de leur incorporation : les recrues alsaciennes et mosellanes sont désormais des Reichsdeutsche, des Allemands du Reich ; certains documents mentionnent : deutscher Staatsangehöriger, citoyen allemand.
Le fait d’être reconnu comme appartenant à la communauté allemande signifie que les Alsaciens-Mosellans sont considérés de sang aryen. La sélection se fonde sur des critères raciaux. Et c’est là que l’incorporation de force se définie comme étant un crime contre l’humanité, même si elle a été jugée comme étant un crime de guerre lors des procès de Nuremberg.
En effet, un crime de guerre est un crime commis en opposition aux lois de la guerre. C’est un acte ponctuel, qui n’est pas nécessairement prémédité. Il se déroule sur une courte durée et contre des victimes qui ne répondent pas à des critères politiques, raciaux ou religieux. C’est le cas, par exemple, de l’horrible tragédie d’Oradour-sur-Glane.
Un crime contre l’humanité, lui, est planifié par un état ennemi et se déroule sur une longue durée. L’Annexion de fait avait été planifiée par le IIIe Reich et l’incorporation de force de citoyens français dans l’armée ennemie s’est effectivement déroulée sur plusieurs années (1942-1945). Outre la durée, un crime contre l’humanité se définit par l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation de civils avant ou pendant une guerre. Les incorporés de force étaient bien des civils qui ont été enrôlés sous la contrainte dans l’armée ennemie.
Le terme de « déportation » est ici important et nous ramène au statut de « déporté militaire » en usage jusque dans les années 50. Les « déportés militaires » sont, selon la définition du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre Laurent Casanova en 1946, les Alsaciens et Mosellans victimes du service militaire obligatoire dans l’armée allemande, une armée étrangère et ennemie, entre 1942 et 1945.
Notons qu’il existe d’autres catégories : « déportés du travail » pour ceux qui ont été enrôlés de force dans le Reichsarbeitsdienst ; « déportés
politiques » pour ceux qui ont été condamnés à mort, à la déportation ou au bataillon disciplinaire ; « déportés et internés de la Résistance » pour les insoumis et déserteurs
incarcérés dans des camps de concentration officiellement reconnus comme tels. L’Etat français a donc bien identifié l’incorporation de force comme une forme de déportation.
Cela nous amène à la dernière caractéristique du crime contre l’humanité : les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, qu’ils soient ou non en violation du droit interne
du pays où ils ont été commis. La « déportation militaire » - fondée sur la menace de mort envers le réfractaire et de déportation de toute la famille en camp de travail
(Sippenhaftgesetz) a uniquement touché les ressortissants de pays des pays conquis reconnus par les nazis comme relevant de la nation allemande. En d’autres termes, les
Volksdeutsche sont considérés comme appartenant à la race aryenne. L’incorporation de force a bien été subordonnée à une sélection raciale.
Fort de ces constatations, il est indubitable que les incorporés de force – plus connus sous le vocable de « Malgré-Nous » - ont été « déportés » dans la Wehrmacht et la Waffen-SS et qu’ils sont les victimes d’un crime contre l’humanité de dimension internationale, puisque d’autres pays que la France ont été touchés (Belgique, Luxembourg, Pologne…). Il reste désormais à convaincre les Etats concernés de les reconnaître officiellement comme tels.
Références :
Les Amis du Mémorial de Caen (éd.), Les incorporés de force 1942-1945. Journées au Mémorial de Caen, le mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022, Caen, 2023
Nicolas Mengus, Les « Malgré-Nous ». L’incorporation de force des Alsaciens-Mosellans dans l’armée allemande, Editions Ouest-France, Rennes, 2025 (1ère éd. 2019).