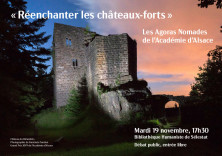Sciences et Humanités : je t'écoute, moi non plus ?
Jean Richet
Au début étaient les Grecs, les présocratiques et l'émergence de la rationalité, Platon, héritier de la logique socratique, le philosophe cultivant la recherche de la vérité et de la beauté, la métaphysique, la politique, les disciplines de la pensée et Aristote touchant à tous les champs connus de la connaissance, ceux de l'esprit et de la matière, l'ontologie, la théologie, la logique, l'éthique, les disciplines de la “philosophie de la nature”, les lettres et les arts.
Ce monde se perpétua bon gré, mal gré sous diverses formes durant une vingtaine de siècles, jusqu'au décrochement culturel de la Renaissance occidentale et du monde moderne, un changement essentiel, la naissance d'une ère nouvelle rompant avec le savoir et la connaissance traditionnels, changement dont les initiateurs s'appelaient Galilée et Newton. La découverte du monde physique se fit désormais à l'aide d'instruments nouveaux, l'expérience, test direct de la matière et de son comportement, les mathématiques, langage efficace et prégnant permettant de traduire, comprendre et maîtriser dans un langage synthétique l'essence de la matière et les phénomènes physiques observés. Ce fut le début d'une ère nouvelle, deux mondes se séparèrent, celui des sciences de la nature et celui des autres domaines du savoir , de la connaissance et de l'expression artistique.
Depuis lors la recherche scientifique procède pour la plupart des cas suivant une démarche inductive, elle cherche à tirer de faits et d'un savoir préalables issus de l'observation une extension des connaissances déjà acquises. Comme dans les autres domaines de la connaissance et de l'art c'est “l'étincelle” générée par une idée intuitive plus ou moins précise et l'imagination de l'individu, l'échange avec les collègues qui déclenche la mise en route du processus mental menant à l'explication cherchée.
A partir de là, la méthodologie est fort différente de celle rencontrée dans les sciences humaines. Elle présente deux volets qui s'enrichissent l'un l'autre.
La démarche expérimentale mène à la création d'un objet nouveau ou met en évidence un processus physique particulier non observé jusque là, confirme ou infirme une théorie existante.
La démarche théorique se nourrit de l'observation expérimentale ou demande l'expérience pour confirmer la validité de la solution qu'elle propose pour expliquer un phénomène observé. Pour cela elle cherche à établir une relation entre les objets et les concepts qui définissent le contexte physique, relation qui se traduit par une formulation mathématique permettant de mettre en évidence l'accord entre le phénomène et son explication.
Pour conjurer l'allusion faussement négative du titre, demeure la question essentielle posée aux humanistes, littéraires, artistes et scientifiques: sommes-nous assez curieux et capables d'échanger sur
un sujet scientifique à l'exemple des échanges entre la création littéraire et artistique?
L'évolution actuelle des sciences de la nature et des techniques est vertigineuse, elle nous interpelle tant sur le plan de la science pure que de ses applications et de ses conséquences dans la vie quotidienne. La démarche scientifique, dans ses aspects formels, peut décourager. Il appartient à l'intervenant d'éveiller l'intérêt et la compréhension de son auditoire par un langage de circonstance. Souhaitons ensemble que
nous ayons la volonté et le courage d'entamer, au sein de l'Académie, des rencontres sur des sujets scientifiques.