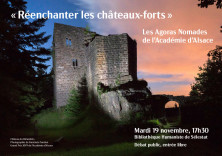La souveraineté de l'IA pour l'Europe Utopie ou réalisme stratégique ?
Par Daniel Guinier
Expert de justice honoraire, ancien expert devant la Cour pénale Internationale de La Haye,
chargé d'enseignement universitaire et conférencier
L'intelligence artificielle (IA) occupe désormais une place centrale qui met en lumière l’asymétrie entre la promesse d’un progrès partagé et la réalité d’une concentration technologique et économique. Elle est plus que jamais un enjeu d’indépendance, appelant à une utopie politique qui vise à reprendre le contrôle sur les outils numériques. Elle est le théâtre d’un réalisme stratégique, où innovation et responsabilité auront à cohabiter. Face à la domination des grandes puissances technologiques, comment la France et l’Europe peuvent-elles construire leur souveraineté en matière d'IA ? Une réponse semble se dessiner, mêlant idéal collectif et lucidité géopolitique, non sans ambiguïtés et inquiétudes…
Introduction
Pour la France et, plus largement, pour l’Europe, la question de la souveraineté numérique se pose avec une acuité croissante. Elle suppose d’articuler ambition industrielle, régulation démocratique et autonomie stratégique, dans un contexte où les intérêts privés et publics s’entremêlent parfois de manière problématique.
Dès 2018, une première phase de la stratégie nationale pour l’IA a été lancée par le Président de la République, avec la mission parlementaire confiée à C. Villani (2018), donnant lieu, en mars 2018, à un rapport substantiel sur la stratégie nationale et européenne.
En septembre 2023, une seconde phase intervient avec l'installation par la Première ministre du premier comité de l'IA générative. Rassemblant des personnalités de différents secteurs, dont certaines sont à l'évidence liées à Google ou Meta, -à l'exemple de J. Barral, directrice scientifique chez Google, et Y. Le Cun, VP et Chief AI Scientist chez Meta-, il a pour but de contribuer à éclairer le Gouvernement, et pour objectif de présenter des propositions concrètes pour adapter la stratégie, avec comme ambition de faire de la France un pays en pointe dans le domaine de l'IA. Son rapport Notre ambition pour la France, déclinant des recommandations essentielles, a été remis au président de la République en mars 2024.
Plusieurs actions concrètes ont suivi, notamment la création d’un organisme d’évaluation : l'INESIA, l'Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle, et des engagements ambitieux à l’échelle nationale et internationale en 2025, en particulier un programme de recherche visant à "faire de la France un champion mondial de la recherche en intelligence artificielle".
Doté de 73 M€ alloués sur une durée de 6 ans, il est piloté par l'INRIA, le CNRS et le CEA ; il ambitionne de structurer les communautés de recherche, lancer des défis et faire émerger des technologies de rupture, - à l'exemple d'un tout nouveau modèle de neurone artificiel (Guinier, 2024) -, en s’appuyant sur l’excellence de l’école française des mathématiques pour ouvrir de nouveaux horizons et attirer les talents du monde entier pour la recherche en IA. Il s'agit aussi d'ouvrir la voie à l’engagement de l’industrie française, en particulier des startups, dans le développement et le déploiement de l’IA.
L’Union européenne (UE) a fait le choix d’une régulation ambitieuse en matière d'IA, avec l’Artificial Intelligence Act de 2024. Ce texte incarne la volonté d’ériger une troisième voie, entre le libéralisme américain et l’autoritarisme chinois, conciliant innovation et protection des droits fondamentaux. Adossé au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la Charte des droits fondamentaux, il trace les fondements d’une souveraineté numérique européenne centrée sur la confiance, l’éthique et l’innovation. L’Europe se trouve confrontée à un dilemme inédit : comment affirmer sa souveraineté dans un monde où l'IA impose ses propres logiques, tout en préservant l’unité de ses États membres ? La France, en position de moteur européen affichée, illustre de manière saisissante les tensions entre ambition collective et intérêts nationaux. Son parcours en matière d’IA révèle un jeu entre régulation normative, compétitivité industrielle et diplomatie stratégique.
Ambiguïtés et contradictions
L’attitude de la France révèle une tension constitutive entre le registre du discours et celui des pratiques. Officiellement, elle réaffirme son attachement à l’idéal d’autonomie stratégique porté par l'UE. Mais, dans le même temps, elle déploie une stratégie nationale centrée sur la mise en valeur de ses propres champions, à l’image de Mistral AI, fondée en 2023, et symbole assumé de sa politique de "startup nation".
Cette double orientation dessine une ambiguïté structurelle : fidélité affichée à l’intégration européenne, mais défense prioritaire d’un intérêt national qui instrumentalise le cadre communautaire. Le développement de "licornes" françaises (le terme "licorne" désignant une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, mais non cotée en bourse), adossé à des capitaux ou des infrastructures étrangères, illustre ainsi les limites d’une souveraineté proclamée mais non consolidée par une politique industrielle commune, durable et cohérente.
Comment articuler l’intérêt national avec l’intérêt européen ? L’Europe promeut la mutualisation comme fondement de son autonomie collective, alors que la France privilégie une logique de rayonnement, qui est susceptible d’apparaître hégémonique, au risque d’éroder la confiance communautaire. Cette tension est amplifiée par la porosité croissante entre sphères publique et privée. Là où l’UE valorise une gouvernance institutionnelle indépendante, ouverte au dialogue multipartite, la France illustre un modèle hybride où l’État se confond avec ses acteurs économiques.
L’exemple de Cédric O, ancien secrétaire d’État devenu cofondateur de Mistral AI et conseiller du gouvernement pour l'IA générative, incarne cette imbrication des rôles (Corlin, 2023) : figure d’une accélération possible de l’innovation, mais source de soupçons éthiques et politiques qui fragilisent la crédibilité française sur la scène européenne.
Ces trajectoires individuelles brouillent les frontières entre stratégie nationale, intérêts économiques sectoriels et intérêt collectif, contribuant à l’opacité des choix de gouvernance. Après la création de l'antenne française de son laboratoire d'IA FAIR (Fundamental Artificial Intelligence Research), en juin 2015 à Paris, Mark Zuckerberg a réaffirmé son engagement pour l'innovation en France en 2018, à l'occasion du sommet Tech for good et de son entretien avec le président de la République, alors que peu avant, il n'avait de loin pas convaincu le Parlement européen concernant la récupération des données de plusieurs millions d'utilisateurs européens de Facebook, se contentant d'excuses, sans répondre sur le fond.
Les contradictions ne sont d’ailleurs pas propres à la France. L'UE critique la domination des grandes entreprises technologiques américaines (BigTech) tout en demeurant réceptive à leurs investissements. Cette dépendance consentie souligne la difficulté de concilier l'attractivité économique et l'autonomie stratégique. L’Europe aspire à se constituer en puissance normative globale. Malgré ses ambitions, elle demeure tributaire des infrastructures et des technologies dominantes.
La France illustre aussi ce paradoxe : en accueillant Google, Meta ou Microsoft, elle attire des capitaux et des talents, mais renforce la dépendance qu’elle prétend réduire. A cet effet, Mistral AI dispose notamment d'un partenariat avec Microsoft, en vue de créer des applications pour les gouvernements européens et répondre aux besoins du secteur public, avec une prise de participation minoritaire de Microsoft au capital de Mistral AI.
Un partenariat avec NVIDEA apparaît également en 2024. Cette tension traduit une fragilité de fond : celle de la difficulté à concilier l’impératif de croissance avec l’idéal d’indépendance. En juin 2024, Mistral AI a levé 600 millions d'euros à l'issue d'un tour où 65 % de son capital restait français. Sur ce point, la startup Mistral AI est loin d’avoir levé autant de capitaux que ses concurrentes américaines. Sa position de pépite à la recherche de fonds pourrait, à plus long terme, la rendre hors de contrôle, soumise à un actionnariat étranger à l’UE, -en particulier dans l’hypothèse d’une entrée en bourse-, avec un risque de délocalisation ou de transfert de contrôle sous influence étrangère. Cela dépendra de sa capacité à sécuriser un financement suffisamment solide, sans perdre de son autonomie stratégique. Au-delà, si Mistral AI comme d’autres entreprises européennes de l’IA ne parviennent pas à se fédérer sous des initiatives communes, cela pourrait les fragiliser davantage face à des coalitions plus grandes et mieux financées à l’échelle mondiale.
Entre les décisions imprévisibles et les exigences brutales, voire les menaces du pouvoir central actuel américain, qui maintient ici son hégémonie par la puissance de ses BigTech et leur allégeance, et la Chine, qui impose un modèle étroitement dirigé par l’État, l’Europe tente de se positionner. Dans ce contexte, la France oscille entre alliance pragmatique pour stimuler son écosystème et volonté affichée de défendre l’autonomie européenne. Cette diplomatie à double face fragilise la cohésion de l’UE, alors que l’unité serait la condition première pour la souveraineté de l'IA.
En conclusion
La souveraineté française en IA ne serait pas en soi contradictoire avec l’idéal européen. Mais, au lieu de s’inscrire comme relais de l’effort collectif, elle tend souvent à s’y substituer, incarnant ainsi l’un des dilemmes les plus persistants de la construction européenne : comment concilier la défense d’intérêts nationaux immédiats avec la poursuite d’un projet collectif à long terme ?
Dans un contexte de rivalité technologique mondiale, face à la puissance des BigTech et à la polarisation sino-américaine, soutenues par d’importants moyens économiques et politiques, la souveraineté en IA ne peut être ni une posture isolée, ni un simple slogan. La France, malgré ses ambitions légitimes et ses succès, -à l'exemple de Mistral AI-, ne bâtira pas une alternative européenne forte en agissant seule. Pour l'UE, les efforts devront porter sur le financement massif de la recherche, en disposant de suffisamment de talents, et en maîtrisant ses propres données. C'est ainsi qu’elle pourra dépasser les modèles actuels et même inventer des technologies de rupture. Pour l'instant, les modèles d'IA sont fondamentalement voisins, et Mistral AI semble encore être la seule société européenne en tête de course à l'IA… Le défi à relever est colossal. La réussite dépendra de la capacité des États membres de l’UE à adopter une vision stratégique réaliste, en alignant leurs ambitions sur un objectif commun, afin que leur souveraineté ne demeure pas une utopie.
Références
Corlin P. (2023) : La double casquette de Cédric O, lobbyiste de Mistral et conseiller du gouvernement pour l'IA générative, La Lettre, 16 novembre.
Guinier D. (2024) : Vers une intelligence artificielle innovante - Rubrique "en débat", sur le site de l'Académie d'Alsace des Sciences, Lettres et Arts, le 4 décembre.
T
oute l’Europe (2018) : Mark Zuckerberg peine à convaincre le Parlement européen, 23 mai.
Villani C. (2018) : Donner un sens à l'intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne. Rapport de mission parlementaire confiée par le Premier Ministre, mars, 234 pages.